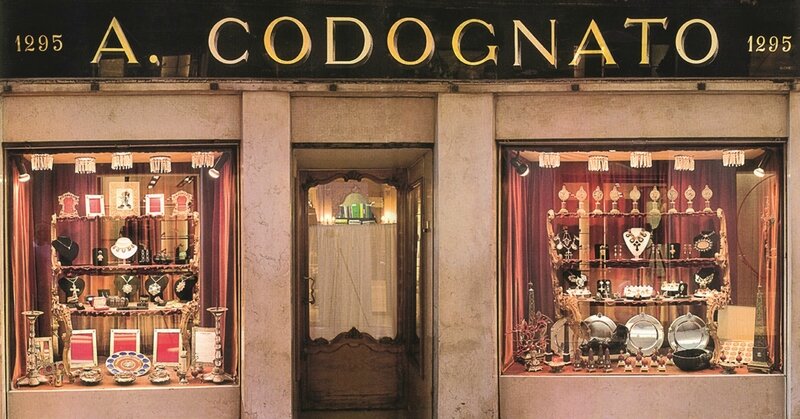Genre : horreur, thriller, aventure (interdit aux - 16 ans à sa sortie, interdit aux - 12 ans aujourd'hui)
Année : 1999
Durée : 1h41
Synopsis : Au cours du violent conflit qui opposa les Etats-Unis au Mexique, une sanglante méprise fit un héros du capitaine John Boyd, homme pusillanime et lâche. Son supérieur hiérarchique n'est pas dupe et l'envoie aux confins enneigés et sauvages du pays, dans une compagnie constituée de singuliers personnages : le commandant Hart, le docteur Knox, Cleaves, le cuistot et Georges, un éclaireur indien. John Boyd est entraîné dans une enquête par l'étrange Colqhoun, qui déclare que ses compagnons de voyage ont été victimes d'un militaire cannibale rendu fou par le froid et la faim.
La critique :
Evidemment, si l'on invoque l'anthropophagie au cinéma, c'est le nom de Cannibal Holocaust (Ruggero Deodato, 1980) qui fait apparaître sa primauté et titille, inéluctablement, l'acuité du spectateur hébété. Pour souvenance, le film choc et polémique (c'est un doux euphémisme !) de Ruggero Deodato a largement estourbi les persistances rétiniennes en son temps et pour cause... Puisque le long-métrage propose des supplices d'animaux bien réels. Au détour d'une saynète rutilante, c'est une jeune femme anonyme, victime de cannibales à l'appétit pantagruélique, qui est carrément crucifiée, puis empalée... A l'époque, Ruggero Deodato est, manu militari, débouté devant le tribunal et sommé de s'expliquer sur les conditions de tournage de Cannibal Holocaust.
Le juge et ses fidèles affidés sont en partie rassérénés. Aucun être humain n'a été exécuté - et donc encore moins empalé - durant le tournage du film.
En revanche, les tortures pratiquées sur des animaux ne sont pas factices, à l'instar de cette tortue gargantuesque et tortorée à pleines dents par des journalistes d'infortune. Autrement dit, au contact de la flore et de la faune animale, l'homme redevient subrepticement cet Homo Sapiens et retrouve, le temps de quelques belligérances, ses réflexes les plus archaïques. Tel est, en filigrane, le message esquissé par Cannibal Holocaust. Entre l'orée des années 1970 et le milieu des années 1980, l'anthropophagie obéira toujours à la même antienne, à savoir des touristes et/ou des aventuriers égarés dans la forêt amazonienne, assaillis puis séquestrés par des cannibales affamés.
Tel sera, entre autres, le principal leitmotiv de Cannibalis - Au Pays de l'Exorcisme (1972), Le Dernier Monde Cannibale (Ruggero Deodato, 1977), Eaten Alive - La Secte des Cannibales (Umberto Lenzi, 1980), La Montagne du Dieu Cannibale (Sergio Martino, 1978), Terreur Cannibale (Alain Deruelle, 1980), ou encore de Cannibal Ferox (Umberto Lenzi, 1981).
Heureusement, l'anthropophagie au cinéma ne se résume pas seulement à cette vision primale, tribale et anthropologique du monde. D'autres films tenteront d'aborder sans fard le cannibalisme sous des angles divergents. Les thuriféraires de ce registre cinématographique n'omettront pas de stipuler des oeuvres telles que Trouble Every Day (Claire Denis, 2001), Le Silence des Agneaux (Jonathan Demme, 1990) et sa pléthore de succédanés, La Route (John Hillcoat, 2009), Les Survivants (Frank Marshall, 1993), ou plus récemment encore Grave (Julia Ducournau, 2016).
Vient également s'additionner Vorace, soit Ravenous dans la langue de Shakespeare, et réalisé par les soins d'Antonia Bird en 1999. A fortiori, rien ne prédestine la réalisatrice à tangenter vers le survival, le gore et l'horreur.
Tout d'abord promise à une carrière théâtrale, Antonia Bird se tourne promptement vers la mise en scène de pièces contemporaines et dramaturgiques. Corrélativement, la cinéaste britannique embrasse une carrière cinématographique élusive et signe, entre autres, des films tels que Priest (1994), De l'Amour à la Folie (1995) et Face (1997). Pour la faribole superfétatoire, Vorace reste son dernier long-métrage en date. Depuis, Antonia Bird a essentiellement tourné des téléfilms (Care en 2000, Rehab en 2003 et The Hamburg Cell en 2004) et des épisodes pour des séries télévisées (notamment Inspecteur Morse). Toutefois, on ne dénote plus aucun travail ni trace de la réalisatrice depuis le milieu des années 2000. Cette dernière semble avoir périclité dans les affres de l'oubli et de la désuétude.
Au risque de réitérer la même antienne, Antonia Bird ne semble partager aucune accointance avec l'horreur en général et l'anthropologie en particulier.
On pouvait donc légitimement se montrer un tantinet circonspect devant Vorace. Le scénario du film s'inspire de faits bien réels et plus précisément de l'expédition Donner qui a eu lieu durant les années 1840. A cette même époque, 81 pionniers américains se retrouvent bloqués dans la neige et semblent condamnés à périr dans le froid et les intempéries. Les autorités procéderont à l'autopsie de 36 cadavres, dont plusieurs seront dévorés. A postériori, les survivants avoueront avoir eu recours au cannibalisme (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_Donner). Pusillanimes, ces mêmes survivants reconnaîtront avoir été exhortés par un certain Alfred Packer, un ancien soldat de la guerre civile américaine. Evidemment, cette histoire atroce est restée dans la mémoire populaire américaine, inspirant par ailleurs la trame narrative de Vorace.
Hélas, pour Antonia Bird, le film se soldera par une rebuffade commerciale. La faute incombe essentiellement à une mauvaise campagne de promotion publicitaire. A contrario, nonobstant son âpreté et sa violence rédhibitoire, Vorace est unanimement plébiscité par les critiques extatiques. Vorace s'arrogera, bien des années plus tard, le statut sérénissime de film culte. Au moment de sa sortie, le métrage écope d'une interdiction aux moins de 16 ans. Cette réprobation sera minorée par la suite pour passer à une simple (si j'ose dire...) interdiction aux moins de 12 ans.
La distribution du film se compose de Guy Pearce, Robert Carlyle, Jeffrey Jones, David Arquette, Jeremy Davies, John Spencer, Stephen Spinella, Neal McDonough et Sheila Tousey. Attention, SPOILERS ! (1) Pendant la guerre américano-mexicaine, le capitaine John Boyd se voit muté dans un fort isolé de Californie après avoir commis un acte de bravoure ambigu.
Arrivéà sa nouvelle affectation, Boyd et la garnison, fort réduite, du fort recueillent un étrange individu traumatisé, Colqhoun, qui leur relate les actes de cannibalisme auxquels il a eu recours alors qu'il était bloqué dans une grotte avec plusieurs personnes. Le colonel Hart, commandant du fort, décide alors de diriger une expédition ayant pour destination cette grotte afin de sauver d'éventuels survivants. Arrivés sur place, Boyd et le soldat Reich descendent dans la grotte et y font une macabre découverte alors que le comportement de Colqhoun est de plus en plus étrange (1).
Indubitablement, Vorace est une oeuvre protéiforme qui oscille et louvoie entre le survival, l'horreur, le gore, l'aventure et le drame intrinsèquement humain. Certes, le film d'Antonia Bird ne partage aucune anaologie - ou presque - avec Cannibal Holocaust et sa floraison d'avatars ; si ce n'est cette intempérance pour la rémanence et la réminiscence de cet archaïsme primitif.
Pour Colqhoun, le cannibalisme se résume de façon dogmatique et de la manière suivante : "Un homme mange la chair d'un autre homme". L'objectif ultime est donc à la fois de se sustenter de cette substance primordiale, de braver ce tabou séculaire et oecuménique et in fine, de s'accaparer l'énergie de son hôte agonisant. Par certaines affinités matoises, le syllogisme de Vorace n'est pas sans réitérer les scansions mortifères de Délivrance (John Boorman, 1972), un autre survival qui mettait déjàà l'épreuve une bande de sportifs aguerris et aux prises avec des rustres épris de tortures et de satyriasis. En outre, Antonia Bird pousse le didactisme de Délivranceà son paroxysme et délivre une critique particulièrement acerbe de l'Humanité, ici engoncée dans le plus vil des barbarismes.
Indiscutablement, Vorace cogne, tabasse et estomaque là oùça fait mal. Par ailleurs, certains producteurs pudibonds sommeront Antonia Bird d'euphémiser ses ardeurs. Mais la réalisatrice n'en a cure même si cette dernière sera obligée de couper quelques saynètes, jugées un peu trop rutilantes, lors du montage final. On comprend mieux le silence assourdissant qui a nimbé cette oeuvre hétéroclite lors de sa sortie en salles. Pourtant, on tient sûrement là l'une des oeuvres les plus insolites et outrecuidantes des années 1990. Seule petite contrariété au tableau, le métrage a tendance à obliquer vers un schéma un peu trop rébarbatif lors de sa dernière demi-heure et repose alors seulement sur l'opposition guerroyeuse entre Colqhoun et John Boyd ; mais c'est juste histoire de faire la fine bouche et de tancer, à titre gracieux, une oeuvre aussi impudente qu'iconoclaste.
Note : 15/20
 Alice In Oliver
Alice In Oliver
(1) Synopsis du film sur : http://chroniqueducinephilestakhanoviste.blogspot.com/2012/10/vorace-ravenous-antonia-bird-1999.html