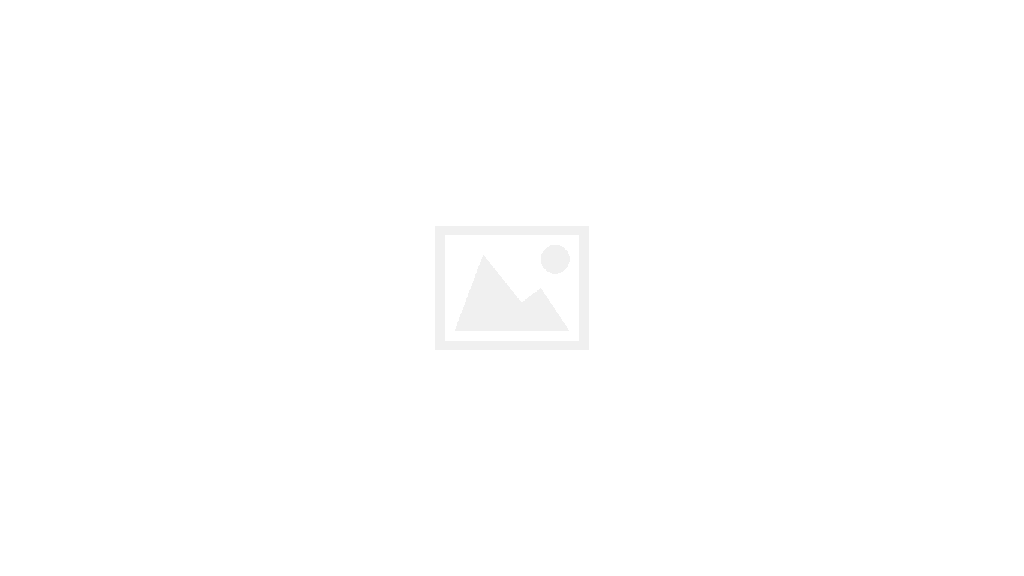Genre : horreur, gore, trash (interdit aux - 18 ans au moment de sa sortie, interdit aux - 16 ans aujourd'hui)
Année : 1979
Durée : 1h34
Synopsis : Lorsque sa fiancée meurt des suites d'un rituel vaudou, le monde de Franck s'écroule. Refusant d'y croire, il se sert de sa passion pour la taxidermie pour embaumer le corps de son amie et la garder auprès de lui. Ayant définitivement perdu tout contact avec la réalité, et aidé par une inquiétante gouvernante, Franck va alors chercher une nouvelle amie. Une femme qui l'acceptera, lui et le cadavre de son ancienne compagne.
La critique :
Réalisateur, cadreur, directeur de la photographie et scénariste, Joe d'Amato est souvent considéré comme le ou l'un des cinéastes les plus prolifiques du cinéma italien. Son nom rime, entre autres, avec le cinéma érotique et pornographique, puisqu'on lui doit de nombreuses pellicules aux titres évocateurs, notamment Emmanuelle's Revenge (1975), Viol sous les Tropiques (1977), Hard Sensation (1980), ou encore Porno Esoctic Love (1980).
Parallèlement, Joe d'Amato se passionne pour le cinéma trash et d'horreur avec des titres tels que Anthropophagous (1980) et Horrible (1981). Parfois, ces films mélangent carrément le gore et le registre pornographique. C'est par exemple le cas du bien nomméPorno Holocaust (1981). On tient donc là un véritable "bisseux" qui a néanmoins suscité la polémique sur ses terres ritales et même en dehors de ses frontières transalpines.
Joe d'Amato est, en l'occurrence, le premier réalisateur, à introduire des scènes hardcore et de cannibalisme déviant dans des films érotiques et/ou pornographiques. Dans le genre horrifique, son style se veut résolument âpre, outrancier et brut de décoffrage. Une didactique corroborée par la sortie de Blue Holocaust en 1979. Au moment de sa sortie, le long-métrage essuie un véritable camouflet, ainsi que les furibonderies de la censure.
Dans un premier temps, le film est interdit de diffusion en France et aux Pays-Bas, avant d'être réhabilité par la suite, via une interdiction aux moins de 18 ans à l'époque, puis aux moins de 16 ans aujourd'hui. En revanche, en Italie, en Allemagne et en Finlande, Blue Holocaust reste encore vouéà l'opprobre et aux gémonies.
Pour toutes les raisons invoquées, le métrage sortira sous divers intitulés, notamment Buio Omega, Beyond the Darkness, Buried Alive, Bio Omega, The Final Darkness, Folie sanglante, ou encore In quella casa... buio omega. Vous l'avez donc compris. On tient donc là un vrai film scandaleux et polémique qui traite de plusieurs thématiques taboues et mortifères, entre autres, le cannibalisme, la taxidermie et surtout la nécrophilie. Bien avant la sortie du bien nommé Nekromantik (Jorg Buttgereit, 1987), Blue Holocaust est donc l'un de tous premiers films à s'engager et à s'aventurer sur ce chemin escarpé. La distribution du film réunit Kieran Canter, Cinzia Monreale, Franca Stoppi, Sam Modesto et Edmondo Vallini. Attention, SPOILERS ! (1) La fiancée de Frank, très malade, succombe aux maléfices d'une vieille sorcière à la solde de la gouvernante de l'inconsolable jeune homme.
Ne pouvant se résoudre à la voir disparaître à tout jamais, rongée par les vers à six pieds sous terre, il décide de voler son corps et de l'embaumer, afin de la garder auprès de lui pour toujours. La taxidermie étant sa marotte, il connaît les secrets de cette pratique peu ragoûtante, si l'on s'en tient à la vision de celle qu'il pratique sur feu sa bien-aimée. La gouvernante, avec qui il entretient une relation plus qu'équivoque, a désormais le champ libre pour s'approprier ce coeur brisé, et si possible la fortune dont il est l'héritier (1). A l'origine, le scénario de Blue Holocaust s'inspire d'un autre film, Il terzio occhio ou Third Eye (Mino Guerrini, 1966), un film italien totalement méconnu en France (source : http://www.psychovision.net/films/critiques/fiche/1238-blue-holocaust).
A tel point que l'on pourrait évoquer un remake, néanmoins beaucoup plus choquant et érubescent que son auguste épigone.
Joe d'Amato n'a jamais été réputé pour verser dans la dentelle ni dans la complaisance. Injustement caricaturéà une sorte de "zeddard" incompétent, la carrière du metteur en scène ne se résume pas seulement au genre pornographique. Dans sa filmographie, on relève tout de même plusieurs pellicules de renom qui méritent entièrement qu'on s'y attarde un peu. En outre, Blue Holocaust fait partie de ces exceptions notables. Ce titre fait partie des films de prédilection des amateurs du cinéma trash et extrême. Et pour cause... Puisqu'on assiste béatement à une longue de démembrement, d'énucléation et à la fois d'embaumement d'une fiancée accidentellement (ou presque...) décédée.
En l'occurrence, Joe d'Amato n'opte pas vraiment - pas du tout - pour la carte de la suggestion. Au contraire, le metteur en scène transalpin choisit de tout montrer et donc de flatter notre voyeurisme via plusieurs saynètes d'une violence inouïe.
Pas étonnant que Blue Holocaust ait écopé d'une interdiction aux moins de 18 ans en son temps et qu'il ait essuyé autant d'épigrammes et de quolibets. Hélas, le premier rituel mortuaire se transmute rapidement en une série de meurtres. Seul, le cadavre de la dulcinée ne suffit plus et ne parvient plus à contenter Frank et sa gouvernante. Amants, les deux tourtereaux s'adonnent et se livrent à des rituels mortuaires et anthropophagiques. En dépit des apparences, Frank est sincèrement énamouré de sa fiancée inhumée. Un amour ici exprimé par des rites cannibalesques.
En prenant et en consommant le corps, l'amour devient ici symbolique et éternel. Hélas, d'autres femmes de passage sont à leur tour victime de ces rituels sociopathiques et frénétiques. Dans un premier temps, c'est une auto-stoppeuse d'allure ventripotente qui subit les foudres de Frank et de sa gouvernante.
La scène se conclura par une décapitation et le déchirement des entrailles. Toutefois, attention à ne pas euphémiser l'uppercut asséné par Blue Holocaust ! Buio Omega ne se résume pas seulement à un film trash et obscène. Joe d'Amato transmue son scénario en huis clos étouffant et anxiogène et étaye cette impression d'isolement permanent dans lequel se sont cloîtrés Frank et sa gouvernante. Blue Holocaust, c'est donc avant tout une atmosphère pesante et comminatoire qui va subrepticement se transformer en folie inextinguible. Contre toute attente, la dépouille sans vie de la fiancée de Frank devient le troisième personnage du film. Bien que décédée et embaumée, la jeune femme joue un rôle central sur la psychasthénie du protagoniste principal.
Que ce soit sur la forme comme sur le fond, Blue Holocaust est probablement le film le plus le plus scabreux de Joe d'Amato. Il est par ailleurs encore plus réussi et abouti que le fameux Nekromantik, souvent considéré comme le parangon sur le sujet toujours spinescent de la nécrophilie. Bref, un vrai classique du cinéma trash.
Note : 15/20
(1) Synopsis du film sur : http://www.devildead.com/indexfilm.php3?FilmID=283