Genre : Drame (interdit aux - 16 ans avec avertissement)
Année : 2012
Durée : 1h42
Synopsis :
Jasna, une adolescente de 16 ans, s’ennuie dans sa petite ville en périphérie de Belgrade, entre les cours du lycée et la vie chez elle, où ses parents n’arrivent plus à dialoguer avec elle. Comme les autres jeunes de son âge, ses seules préoccupations sont de faire la fête, de rencontrer des garçons et de se filmer en permanence avec son téléphone portable. Jasna tombe folle amoureuse de Djole, un garçon de son école. Prête à tout pour lui plaire, Jasna sombre vite dans les excès de l’alcool, du sexe et de la drogue.
La critique :
Indubitablement, le cinéma d'Europe de l'Est n'a jamais été particulièrement popularisé parmi la population. Considéré comme austère, les films de cette région d'Europe ont souvent été associés aux cinéphiles élitistes. Il est vrai que peu de gens autour de vous connaîtront Andrzej Wajda, Aleksei Balabanov ou même Béla Tarr ou Andreï Tarkovski. Pourtant, il serait fort malhonnête que de ne pas reconnaître la richesse inestimable de ce Septième Art dont les connaissances peuvent parfois être perfectibles. Un cinéma de pointe dont il n'est pas rare d'échapper à certaines facettes.
Je pense à la Nouvelle Vague tchécoslovaque qui est l'un des meilleurs exemples. Le pays qui nous intéressera, aujourd'hui, est la Serbie dont le cinéma est l'un des plus importants d'Europe de l'Est. Très peu développé avant 1945, il a connu par la suite un essor fulgurant grâce au pouvoir communiste yougoslave qui en avait fait un instrument de divertissement, d'éducation et d'endoctrinement du peuple. Il est parvenu par la suite à se faire connaître sur la scène internationale. Son représentant est systématiquement désigné par Emir Kusturica, l'un des très rares à avoir obtenu deux Palmes d'Or au Festival de Cannes.
Par le passé, le blog a déjà eu affaire à ce pays avec les très violents The Life and Death of a Porno Gang et, bien sûr, A Serbian Film que nous ne présentons plus. Peut désormais se rajouter Clip réalisé par Maja Milos dont il s'agit du premier long-métrage. La jeune "Belgradoise" n'avait réalisé que des court-métrages jusqu'alors. Deux longues années auront été nécessaires pour que le projet puisse voir le jour entre l'écriture du scénario et un tournage s'étalant sur 8 mois. De quoi interroger sur le pourquoi d'une telle durée. Cependant, au moment de sa sortie, Clip est sélectionné dans de nombreux festivals internationaux et obtiendra plusieurs distinctions.
Citons le Grand prix du festival de Rotterdam ou le Prix du Meilleur premier film à Bruxelles. Un pedigree loin d'être négligeable et qui a le mérite de mettre en confiance. Parallèlement, le film provoque quelques remous et des rumeurs concernant une probable interdiction en Russie. Il ne se verra, au final, flanqué que d'une interdiction aux moins de 18 ans. Traînant derrière lui comme un léger parfum de scandale, Clip divisera la critique spécialisée alors que les critiques publiques se montreront plus enthousiastes. Lesquels ont raison ?
ATTENTION SPOILERS : Jasna, une adolescente de 16 ans, s’ennuie dans sa petite ville en périphérie de Belgrade, entre les cours du lycée et la vie chez elle, où ses parents n’arrivent plus à dialoguer avec elle. Comme les autres jeunes de son âge, ses seules préoccupations sont de faire la fête, de rencontrer des garçons et de se filmer en permanence avec son téléphone portable. Jasna tombe folle amoureuse de Djole, un garçon de son école. Prête à tout pour lui plaire, Jasna sombre vite dans les excès de l’alcool, du sexe et de la drogue.
Par certaines thématiques liées à la descente en enfer vertigineuse d'une jeune fille, Clip n'est pas sans rappeler, avec quelques différences notoires, le bouleversant Moi Christiane F. 13 ans, droguée et prostituée. En l'occurrence, le film ici va se focaliser sur Jasna, une adolescente fortement délurée de 16 ans évoluant dans un Belgrade dévasté et d'une pauvreté ancrée dans chaque brique de chaque bâtiment. On le sait, la Serbie n'est pas un pays réputé pour son essor économique et son niveau de vie foudroyant. Milos va filmer cette précarité oppressante frappant des individus soumis à cette cruelle fatalité. Jasna est cette fille en pleine crise d'adolescence. Ayant développée une passion pour la nymphomanie, elle est aussi en décalage avec une famille envers laquelle elle manifeste une hostilité frappante. Une famille que l'on ressent comme ne roulant pas sur l'or.
Clip va se focaliser sur cette population vouée au fatalisme de l'échec et semblant être abandonnée par sa propre patrie. Ainsi, est-il nécessaire, d'autant plus pour les jeunes, de chercher à s'évader. Face à une vie flasque et terne, l'alcool et très rapidement la drogue vont faire leur entrée. Milos met en reflet cette nouvelle génération perdue. Cette génération incomprise et hors d'éducation. Cette génération condamnée à son propre sort, à vivre dans la précarité en ayant un boulot peu reluisant, si tant est qu'ils parviennent à en avoir un.
Mais pas que ! L'analyse sociologique n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. La réalisatrice va aussi se focaliser sur les rapports interindividuels, se concentrant surtout sur le sexe féminin. Qualifier Clip de film féministe ne serait pas un oxymore. Les filles sont affichées comme perdues, peu épanouies et ne chercheront de reconnaissance du sexe opposé que par le coït. Une manière pour elles de se sentir aimées. Une impression bien évidemment faussée vu qu'elles feront juste l'objet des desiderata des hommes les réduisant à un bout de chair juste bon à pénétrer avant de le laisser sur le côté. Le pire étant qu'elles se satisfont de cette conception biaisée de l'amour, et surtout Jasna.
Oui, Jasna c'est cette fille qui va en profiter à côté pour afficher chaque moment heureux de sa vie en le filmant comme pour faire le clip de sa propre vie. Un clip pour le moins triste car ses seuls moments de bonheur se feront un pénis dans la bouche, le vagin ou l'anus ainsi que des soirées en état comateux. Pas d'épanouissements intellectuels. Les banalités reviennent et tournent comme dans le cercle infernal d'une vie maudite. Clip traduit ce malaise adolescent de vouloir afficher sa vie aux autres, de montrer aux autres que l'on a une vie heureuse sur les réseaux sociaux. Mais la réalité est loin, très loin de ça... Pour ces filles, pas d'amour possible. La notion même de relation amoureuse sérieuse n'y est même pas pensée. La reconnaissance et l'amour ne peuvent se faire que par le rapport sexuel sans s'imaginer un seul instant qu'elles ne sont que des jouets réutilisables et interchangeables.
Autant prévenir de suite que les amateurs de cinéma trash et extrême pourront passer leur chemin car sous ses dehors de film frôlant l'interdiction aux moins de 18 ans, rien d'excessif dans la violence n'est au programme. Clip est avant tout un drame social qui tape là oùça fait mal. L'interdiction viendra bien évidemment des rapports sexuels filmés sans retenue et flirtant dangereusement avec la pornographie. Certaines séquences allant jusqu'àêtre filmées par Jasna avec son portable ou même par un mec. Des scènes crues au malaise renforcé par le fait que ces filles sont affichées comme mineures. Milos nous place dans un état de voyeur pédophile face à cette sexualité déviante.
Fellations, éjaculations faciales, sodomies, voilà les choses auxquelles vous pourrez assister via ces "mineures" (comprenez bien que toutes ces performances sont faites par des personnes majeures bien sûr !!!). On peut sans trop de problème évoquer le fait que le métrage se gratifie d'un second niveau de lecture passionnant en tout point. Un second niveau de lecture d'actualité. Cependant, le constat en qualité s'arrêtera bel et bien là car Clip risque de sérieusement décevoir au-delà de ça.
Il faudra mentionner une mise en scène très lourde et plate. Les séquences inutiles se succèdent à un rythme assez fréquent. Autant dire que si vous avez passé une mauvaise nuit, cette pellicule ne vous aidera pas à garder les yeux ouverts. La déception du pedigree peut aussi s'étendre à une histoire qui ne décollera jamais vraiment. Pendant 1h42, on suit la même vie répétitive de Jasna, les soirées, les cours, les soirées, traîner dehors, les cours, une dispute familiale, les soirées, etc, etc. Quelques intrigues parallèles sont à noter comme ce père mal en point qui attend son opération ou l'idylle tendancieuse entre Jasna et Djole. Seulement, rien ne permet de nous agripper, de s'intéresser suffisamment à l'histoire. La réalisatrice balance très bien ce brillant constat d'une jeunesse désabusée mais sans que rien ne suive derrière. Il n'y a pas de travail de psychologie des personnages au fur et à mesure de l'avancée du film. La fin est amenée de manière trop brusque.
Un raccourcissement de 20 minutes n'aurait pas été de trop. On s'éternise sur des détails insignifiants. Inutile de filmer 50 soirées ! On a compris à un moment donné ce que la réalisatrice veut faire passer comme message.
Pire encore, ce propos brillant sera gâché par une tendance à ratiociner inutilement juste au cas où le spectateur bête à manger du foin n'aurait rien compris. Durant les soirées, on se retrouvera toujours avec des musiques serbes narrant les errances et l'abandon de la jeunesse. Où est le cinéma professionnel là-dedans ? On a surtout un travail grossier sur la bande son par son manque flagrant de subtilité. Certes, d'un point de vue esthétique, on sera surpris du traitement de qualité de cette Belgrade post-apocalyptique semblant être tout droit sortie hier de la Guerre de Yougoslavie. Cette atmosphère vétuste est d'un remarquable rendu, mais le procédé found-footage intégré au récit apporte son lot de défauts. La caméra n'est pas toujours bien pensée et certains plans seront très approximatifs. Pour ce qui est des acteurs, là il faut bien avouer que le tout remonte. Des acteurs non professionnels ont été choisis pour incarner les personnages du film.
Cela permet d'apporter une certaine authenticité et du désir de donner au film un aspect documentaire. Nous retrouverons Isidora Simijonović, âgée de seulement 14 ans lors du tournage du métrage, dans le rôle de Jasna. Inutile de dire que les rapports sexuels seront faits via des doublures. Une fille extrêmement bien impliquée dans la peau de cette adolescente tourmentée. De manière générale, la Serbie confirme sa réputation de pays aux filles belles à nous faire tomber dans les pommes. Même si elles sont affichées comme des personnes vulgaires (mais sacrément émoustillantes), elles ne savent pas se détacher de leur beauté naturelle et de ce charme type. Bref, après ce court passage sous testostérone en ébullition, autant dire que les mecs se débrouillent bien également. Pas de faux pas notoire !
Mais bon, si le recul fut nécessaire pour éviter de noter à chaud ce film, Clip parvient à décevoir le spectateur, alors que tout était là pour en faire un chef d'oeuvre. On reste pantois devant la richesse et la complexité des thématiques proposées : la jeunesse face à la pauvreté, les réseaux sociaux vecteurs d'une image faussée de ce monde malheureux, l'incompréhension des rapports homme-femme. Avec un second niveau de lecture proche de la perfection, le plus dur était fait mais tout le reste se rétame lentement mais sûrement. Psychologie des personnages unidimensionnelle et sans évolution, rythme d'une lenteur indigeste, bande son lamentable, récit qui n'en est pas un, durée bien trop longue pour ce que le scénario a à nous raconter, plusieurs séquences sans intérêt.
On a un peu cette impression que la réalisatrice a tout misée sur un seul point en négligeant tout le reste. Du coup, la note en pâtit sérieusement. Un énorme potentiel gâché par des ambitions un peu trop grandes pour une réalisatrice qui débute, peut-être ? Les meilleures graines furent plantées pour nous offrir un futur classique du cinéma sans prétention quelconque. Ceci dit, il convient de dire que Clip est typiquement ce genre de film qui doit mûrir avant d'être jugé comme tel. Quoi que l'on en dise, les réalisateurs qui déçoivent au premier métrage existent en nombre et ont touché même certains maîtres. Kubrick lui-même ne s'était pas bien illustré dès ces débuts. En attendant, le potentiel est bien là et nous ne pouvons que souhaiter àMilos de se perfectionner. Peut-être tiendrons-nous dans un futur proche UNE Emir Kusturica ?
Note :10/20









 Alice In Oliver
Alice In Oliver




 Alice In Oliver
Alice In Oliver



 Inthemoodforgore
Inthemoodforgore



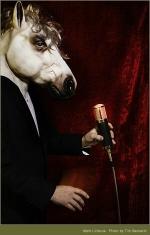 Alice In Oliver
Alice In Oliver











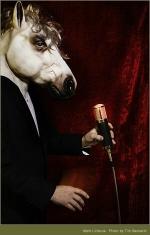 Alice In Oliver
Alice In Oliver













 Alice In Oliver
Alice In Oliver











 Alice In Oliver
Alice In Oliver







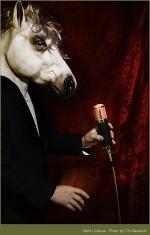 Alice In Oliver
Alice In Oliver








 Alice In Oliver
Alice In Oliver








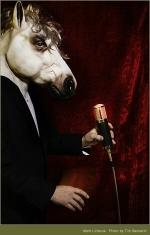 Alice In Oliver
Alice In Oliver