Genre : underground, clip musical, horreur, gore, trash, extrême, expérimental (interdit aux - 18 ans)
Année : 1992
Durée : 20 minutes
Synopsis : (1) Un psychopathe torture une personne choisie au hasard, puis la force à regarder des clips de Nine Inch Nails (1).
La critique :
Une fois n'est pas coutume. Le blog Cinéma Choc glane aussi les avis et l'érudition de ses fidèles commentateurs. Lors de la chronique du film Flesh of the Void (James Quinn, 2014, source : http://cinemachoc.canalblog.com/archives/2018/03/20/36241701.html#comments), un certain Plug-in-lust a mentionné, avec beaucoup de minutie et de déférence, le court-métrage intituléBroken, et réalisé par les soins de Peter Christopherson en 1992.
Ce court-métrage possède pour particularité de coaliser à la fois le cinéma underground, le gore, le trash, l'extrême, la torture, le sadomasochisme ad nauseam et l'expérimental, le tout entrecoupé de divers clips musicaux (Wish, Help me i'm in hell, Happiness in slavery et Gave Up) du groupe de metal industriel américain Nine Inch Nails.
Pour mieux comprendre et cerner les attributs et la singularité de Broken, encore faut-il se polariser sur le groupe Nine Inch Nails lui-même et en particulier sur l'album éponyme, lui aussi sorti en 1992. Nine Inch Nails, c'est avant tout une aura charismatique et quasi hégémonique sous la férule, presque despotique et exclusive, de Trent Reznor ; à la fois compositeur, musicien, instrumentiste, producteur et chanteur. L'artiste protéiforme affectionne tout particulièrement les albums concepts et complexes (si j'ose dire...), transis par les thématiques du chaos, de l'agonie, de l'eschatologisme, de la violence, de la mort ou de la prégnance de certaines religions, mais aussi et surtout de la décrépitude d'une société eudémoniste et arc-boutée dans ses fêlures et son consumérisme.
Pour marteler son message, pour le moins âpre et rédhibitoire, Trent Reznor insiste lourdement sur l'aspect visuel, notamment lors de concerts fulgurants et luminescents.
Sa culture et ses références pléthoriques, parmi lesquelles on trouve des artistes tels que Ministry, Killing Joke, David Bowie, Alice Cooper et même Depeche Mode (entre autres...), deviennent alors les nouvelles effigies du milieu underground. Les thuriféraires de ce registre citent aisément Broken, The Downward Spiral (1994) et The Fragile (1999) parmi les albums les plus rémanents de Nine Inch Nails. Le disque Broken est originellement conçu comme la réponse véhémente au label TVT qui souhaite dévoyer l'univers de Trent Reznor vers d'étonnantes tortuosités.
En outre, TVT exhorte l'intéresséà euphémiser ses ardeurs. Heureusement, la requête de TVT ne sera pas ouïe par le chanteur atrabilaire. C'est même un véritable doigt d'honneur qu'il assène au label discographique.
De l'aveu même de Trent Reznor, Broken sera un EP ("extended play") inspiré par le souffle de la destruction (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nine_Inch_Nails) et de la néantisation. Le musicien requiert alors les soins et la dextérité de Peter Christopherson pour réaliser un court-métrage homonyme, donc Broken (au cas où vous n'auriez pas suivi...). En raison de ses diverses impudicités et de son extrême violence, le film ne sera jamais diffusé et sera même banni, inlassablement ostracisé et vouéà l'opprobre et aux gémonies. Selon certaines sources fiables, il existerait, à fortiori, quelques copies pirates en VHS de ce court-métrage. Donc, avis aux collectionneurs et/ou aux amateurs de Nine Inch Nails pour déceler cet OFNI (objet filmique non identifié). Que les amateurs de sensations fortes se rassérènent...
Il existe néanmoins un lien sur la Toile pour dénicher ce trésor d'indécence (source : https://archive.org/details/NineInchNails-Broken#, encore une fois, merci à Plug-in-lust pour sa mansuétude et son omniscience !).
Trent Reznor reste probablement la personne la plus avisée pour évoquer le cas si particulier de Broken et pour s'enhardir du scandale qui a auréolé la pellicule au moment de sa sortie : "Ce n’était pas une décision consciente de faire la chose la plus vulgaire que nous pouvions envoyer à la presse, alors que l’on pourrait facilement le croire. Mais c’était une chance pour moi de finalement être capable de faire quelque chose que je voulais sans avoir à demander à quiconque son putain d’avis.
La question s’est posée : Jusqu’où peut-on aller ? J’ai dit aussi loin que l’on pense qu’il le faut, oublions que c’est un vidéo clip, oublions les standards et la censure. Heureusement ou malheureusement, suivant du coté où l’on se place, c’est "indiffusable". Nous savions lorsque nous le faisions que nous irions trop loin, que l’on atteignait les limites de ce qui est diffusable à la TV américaine, mais ca nous intéressait.
Quand on a fini, on a pensé - au moins 10 minutes - à en faire une version Edit pour être vue... mais c’était ça que je voulais, j’avais exprimé la chanson du mieux possible que je pouvais. Ce n’était pas une idée calculée de mettre le pénis de quelqu’un dans une vidéo". (source : http://ninfrance.free.fr/histoire/histoire9.html). En l'état, difficile de narrer, avec une certaine méticulosité, un court-métrage de la trempe de Broken, puisque ce film de vingt minutes ne contient pas vraiment de scénario ni de schéma rationnel.
A contrario, on subodore tout de même une trame narrative, assez frêle, il faut bien le dire. C'est donc ce que nous allons tenter de décrypter et de métaboliser à travers nos colonnes. Attention, SPOILERS ! Broken débute sur une pendaison, puis s'achemine instantanément sur toute une série de tuyauteries et de canalisations conduisant dans une immense salle de bains.
Un homme, entièrement drapé de frusques à caractère fétichiste, git de douleur et pour cause... puisque l'infortuné est affublé d'un énorme tuyau de douche dans la cavité buccale et éructe régulièrement de l'eau par les différents orifices. Puis la séquence cauchemardesque s'arrête pour ensuite se centrer sur les activités ignominieuses d'un tueur en série. Dès lors, la réalisation onctueuse de Peter Christopherson se transmue en une pellicule amateur, voire à un snuff movie à la violence rédhibitoire. Le maniaque oblige sa victime à mater plusieurs clips musicaux du groupe Nine Inch Nails.
L'homme mutilé et supplicié est même suspendu au plafond d'une cave pour supporter les impudicités de son tortionnaire. Puis, derechef, le court-métrage oblique vers une autre direction pour cette fois-ci se focaliser sur un homme entièrement dévêtu et ingurgitant un repas frugal.
L'homme en question dévore même à pleines dents des centaines de brachycères s'apposant sur la nourriture. Puis, sans fard, un nouveau clip de Nine Inch Nails fait irruption. Cette fois-ci, c'est au tour d'un quarantenaire de subir les rouages d'une machine infernale qui étrille et dilacère la victime à coup de broyeurs et de perforeuses. La peau, éparpillée en lambeaux, ressort d'une sorte de mixeur rutilant. In fine, Broken se conclut de nouveau sur son psychopathe originel. Le forcené arrache le sexe turgescent de sa victime et s'imbibe du sang abondant de ce dernier.
La séance débouche sur une séquence de viol et même de nécrophilie sur une dépouille putrescente et bientôt disséquée à coup de scalpel et d'opinel. Le sociopathe s'acharne sur sa proie en anatomisant ses tripes, ses organes, ses boyaux et ses viscères. Clap de fin ou presque... Puisque Broken se termine de la même façon qu'il avait débuté, donc sur une pendaison. En l'état, difficile d'analyser et de ratiociner sur un tel court-métrage, pour le moins alambiqué.
A travers Broken, Peter Christopherson parvient à conjecturer les fantasmagories de Trent Reznor sur pellicule via les thématiques prédominantes de l'autodestruction, de la torture, de la mort, de la violence, de la putréfaction et de l'annihilation. Toujours la même ritournelle... Difficile également de ne pas ressortir estourbi, voire estomaqué, d'une telle séquence chirurgicale tant le long-métrage cherche à faire ciller (vaciller...) nos persistances rétiniennes.
Pas de note finale pour ce court-métrage, aussi énigmatique que répugnant...
Note :?
 Alice In Oliver
Alice In Oliver








 Inthemoodforgore
Inthemoodforgore



 Alice In Oliver
Alice In Oliver










 Alice In Oliver
Alice In Oliver



























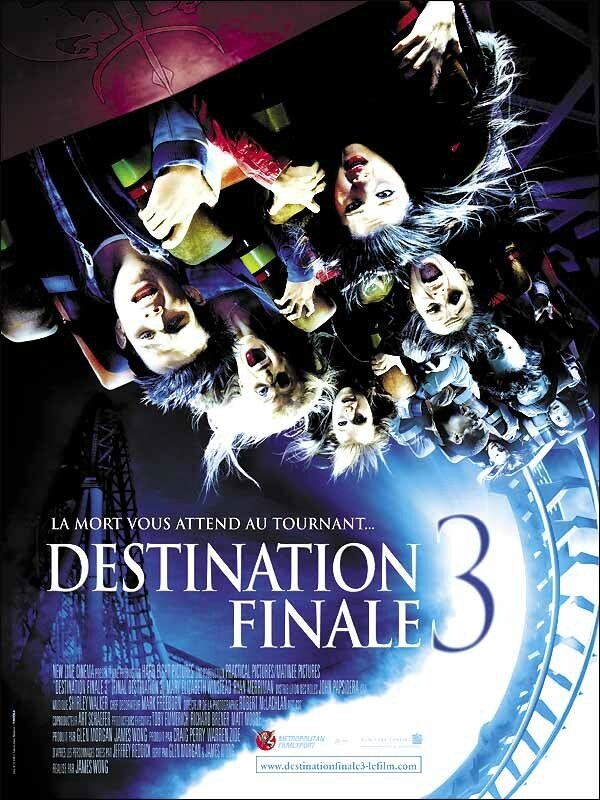































 Alice In Oliver
Alice In Oliver