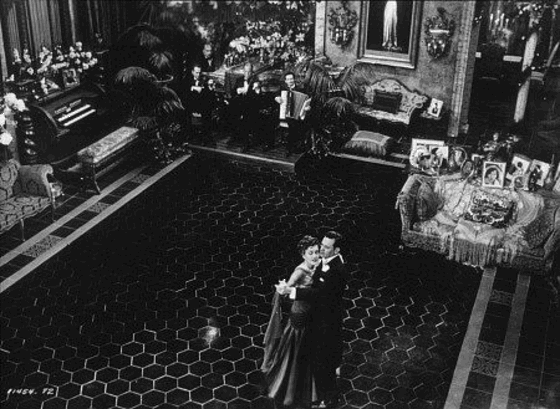Genre : horreur, épouvante, science-fiction
Année : 1958
Durée : 1h13
L'histoire : Introduite dans un campus, une araignée géante présumée morte se réveille au son du rock'n'roll.
La critique :
Que ce soit en tant que réalisateur, producteur ou scénariste, Bert I. Gordon s'est toujours passionné pour les séries B science-fictionnelles, fantastiques et d'épouvante. Certes, Bert I. Gordon n'est certainement pas un grand nom du noble Septième Art, mais il fait partie de ces artisans honnêtes aux multiples influences. En outre, la carrière du cinéaste commence dès 1954 avec une production assez obscure, Serpent Island. Par la suite, Bert I. Gordon enchaîne les bisseries impécunières : Beginning of the End, The Amazing Colossal Man, Attack of the Puppet People et War of Colossal Beast assoient sa notoriété.
Fervent admirateur du cinéma de Jack Arnold (L'étrange créature du lac noir et surtout L'homme qui rétrécit), Bert I. Gordon se passionne lui aussi pour le gigantisme et son antagoniste, à savoir cette atome primordial et infinitésimal.
En hommage au chef d'oeuvre de Jack Arnold (donc L'Homme qui rétrécit), Bert I. Gordon réalise lui aussi plusieurs films sur d'étranges cas de gigantisme ou de miniaturisation sous l'effet de radiations nucléaires. Nous sommes dans les années 1950, donc en pleine Guerre Froide entre les Etats-Unis et la Russie. Le monde entier vit dans la peur d'une Troisième Guerre Mondiale.
C'est dans ce contexte de paranoïa ambiante que sort Earth Vs. The Spider en 1958. Nanti d'un modeste budget, cette série B doit être la réponse àTarantula !, un autre film réalisé par Jack Arnold en 1955. A l'instar de son illustre modèle, Earth Vs. The Spider va lui aussi marquer les esprits. Le public se précipite dans les salles et pousse des cris d'orfraie devant cette araignée à la taille démesurée.
En 2001, le long-métrage de Bert I. Gordon fait l'objet d'un remake homonyme (sous la forme d'un téléfilm), cette fois-ci réalisé par les soins de Scott Zielhl. La distribution de cette première version ne réunit pas des acteurs très connus, à moins que les noms de Ed Kammer, June Kenney, Eugene Persson et Gene Roth vous disent quelque chose. Mais j'en doute. Le scénario de Earth Vs. The Spider est plutôt simpliste et laconique. Attention, SPOILERS !
Jack Flynn disparaît mystérieusement près d'une grotte isolée au beau milieu de la nature. Sa fille, Carol, part à sa recherche en compagnie de son fiancée, Mr. Kingman (Ed Kammer). Arrivés dans la fameuse caverne, ils trouvent un endroit rempli de dépouilles humaines, puis le cadavre du père de Carol.
C'est sans compter sur l'arrivée soudaine d'une araignée géante. Epouvantés, Carol et son énamouré se précipitent au poste de police. Tout d'abord dubitatifs, le sergent et son équipe se rendent à leur tour dans la tannière de l'arachnide. Le cauchemar ne fait que commencer... Vous l'avez donc compris. Le scénario n'est pas spécialement le gros point fort de Earth Vs. The Spider.
Surtout, il n'est qu'un copier-collé ou une photocopie de Tarantula ! (que j'ai déjà cité). D'ailleurs, pour les effets spéciaux du film, Bert I. Gordon utilise la même technique, à savoir une véritable araignée (évidemment) filmée en gros plan pour donner une impression de grandeur. Contrairement au film de Jack Arnold, Bert I. Gordon ne fournit aucune explication sur les incroyables rotondités de son araignée à l'appétit aiguisé.
De surcroît, le réalisateur confère à son arachnide une aura énigmatique, maléfique et cosmologique. Ce monstre, cette créature à huit pattes semble être le produit ou le résultat du néant, de ce mal, de ce vide indicible, qui surgit de nulle part. Comme un symbole, l'animal se cache dans une tannière, un endroit obombré et emblématique qui sépare notre réalité pragmatique et un autre univers, celui des limbes de l'Enfer. Il ne s'agit pas seulement de vaincre une araignée géante, mais de détruire cette menace invisible, cette pulsion archaïque et primitive qui semble être à l'origine de notre instinct profondément animal, celui qui guide nos actions barbares et guerrières.
Encore une fois, ce n'est pas un hasard si le film se déroule dans un contexte de guerre froide et de radiations nucléaires.
Earth Vs. The Spider se situe dans la lignée de La Mouche Noire, de Kurt Neumann en 1958, un autre classique du cinéma d'épouvante. Plus que jamais, l'homme se retrouve ici confrontéà son propre miroir et donc à sa propre monstruosité. Telle est la dynamique ostentatoire de tous ces films horrifiques. En l'occurrence, Bert I. Gordon parvient parfois à transcender son sujet.
Dans un premier temps laissée pour morte, l'araignée géante est exposée dans un musée. Hélas, par la suite, l'animal se réveille, déclenchant l'hystérie et la panique générales. Certes, au risque de me répéter, le scénario de Earth Vs. The Spider suit un cheminement assez classique : la découverte de l'araignée, sa capture, son réveil puis la destruction d'une ville... Toutefois, cette série B se suit sans déplaisir. Les amoureux du cinéma bis et des vieilles pellicules horrifiques devraient logiquement trouver leur compte.
Note : 12.5/20